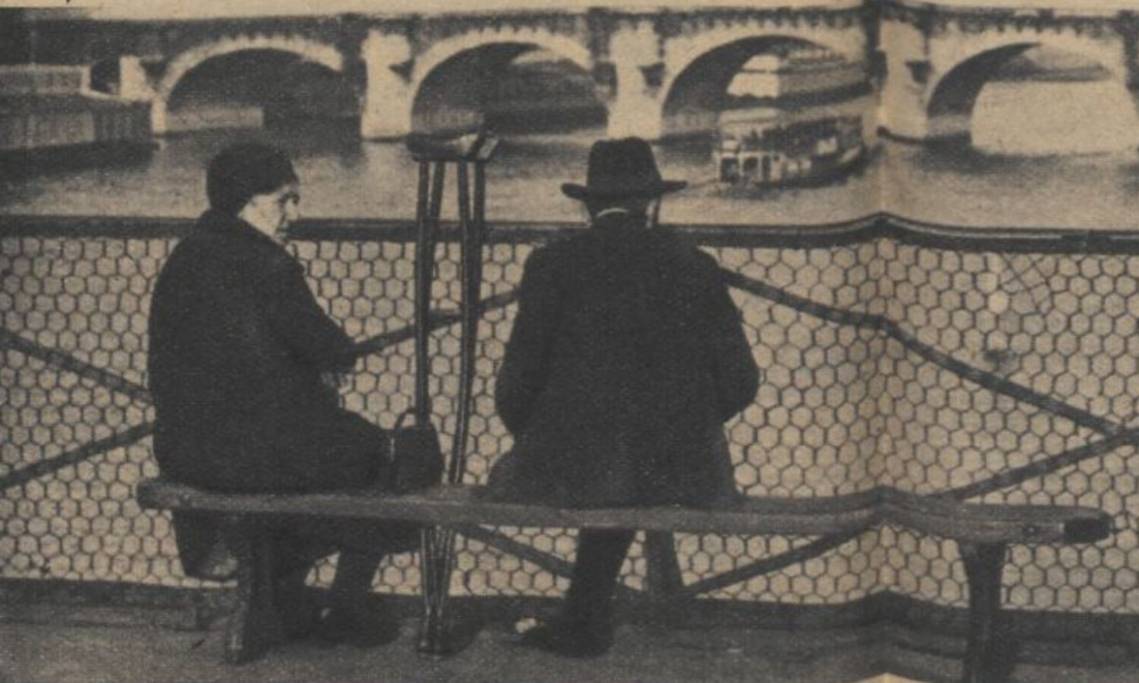Gyula Halász arrive à Paris en 1924 pour ne plus jamais repartir. Le jeune artiste retrouve quelques amis berlinois et étend rapidement son réseau. Sociable et charismatique, il multiplie les rencontres, explorant la ville sous toutes ses coutures, mondaines et populaires, de jour et surtout de nuit. Il exerce sous plusieurs pseudonymes, reflet de ses nombreuses activités : rédacteur pour un journal sportif hongrois puis pour plusieurs titres allemands, il travaille également comme dessinateur et caricaturiste. Il se fait par ailleurs brocanteur, achetant des photographies et cartes postales anciennes qu’il revend à son entourage – André Breton, Paul Eluard, Salvador Dalí notamment.
Halász laisse peu à peu la peinture de côté. En plus de ses nombreux métiers, il devient agent de photographes pour les besoins de la presse, qui le charge de trouver des clichés pour illustrer ses articles. Celui qui n’avait jamais envisagé la photographie, la prenant même de haut, commence à s’y intéresser. En 1925, il rencontre Eugène Atget, qui sera un modèle pour lui comme pour beaucoup de ses contemporains. Mais la rencontre décisive est celle d’André Kertész, un an plus tard, qui finit de le convertir et l’initie à la technique. La photographie se révèle être une vocation. En 1929, Brassaï acquiert un appareil et se jette tête baissée dans cette nouvelle passion.
Brassaï aménage une chambre noire à son hôtel afin de réaliser ses propres tirages. Il cherche à anoblir l’ordinaire, et pour cela il réalise des photographies en gros plan d’objets du quotidien : une paire de ciseaux, des allumettes, une bougie, des coquillages… Tant de photographies où, selon les mots du journal Carrefour, « la banalité du sujet en soi rejoint l’exception rare ».
Il produit toute une série, Objets à grandes échelles, dont certaines images sont publiées dans The New Review et n’échappent pas au Chicago Tribune :
« La photographie en frontispice, réalisée par Brassai, exige une attention particulière comme exemple des effets étonnants que l'on peut obtenir en photographiant des objets aussi ordinaires qu'une paire de ciseaux et une allumette. »