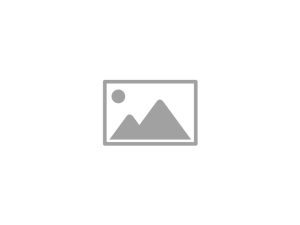Dossier
L'École républicaine : une institution de la Troisième République
Image de couverture
Une salle de classe à l'école Lavoisier, dans le 5e arrondissement de Paris, Agence Rol, 1921 - source : Gallica-BnF
Au début de la Troisième République, sur les cendres encore chaudes des poussées démocratiques de La Commune, les lois Ferry de 1881 et 82 inaugurent une révolution éducative majeure : la création d'une école laïque, gratuite, obligatoire et suivant un programme commun à toutes les régions et toutes les classes sociales françaises.
RetroNews se propose de revenir sur la genèse et l'adoption progressive de cette idée révolutionnaire par la France entière, sur la création d'une nouvelle figure, le « maître d'école», de même que sur les nombreuses critiques et évolutions dont cette nouvelle institution a fait l'objet depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.