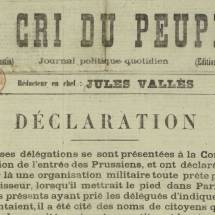Combat, 1946 : quand Camus rêvait d'une « civilisation du dialogue »
Un an après la fin de la guerre, Albert Camus publie dans Combat « Ni victimes ni bourreaux », une série de huit articles sur la question de la violence politique. L'écrivain, exprimant sa défiance des idéologies, y dessine les contours de ce que pourrait être « un monde pacifié ».
Novembre 1946. Un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde se reconstruit. Deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, dominent la politique internationale, dans un début d'affrontement stratégique et idéologique que l'on appellera bientôt la Guerre Froide. Dans les années à venir, l'opposition entre les deux « blocs » s'accompagnera de la menace croissante d'un affrontement nucléaire.
C'est dans ce contexte qu'Albert Camus, rédacteur en chef du journal issu de la Résistance Combat, va se pencher sur la question de la violence politique et de sa légitimation, dans une série de huit articles publiés du 19 au 30 novembre sous le titre de « Ni victimes ni bourreaux ».
Comment, s'interroge Camus, après Hiroshima (un événement qu'il fut le premier intellectuel occidental à dénoncer), construire les bases d'un « monde pacifié », où primeraient le dialogue et la démocratie, et où le meurtre ne serait plus « légitimé » par les « idéologies », qu'elles fussent de gauche ou de droite ?
« Notre XXe siècle est le siècle de la peur », écrit-il en préambule dans le premier article, prenant acte du gouffre dans lequel la guerre a plongé la civilisation toute entière :
« Le long dialogue des hommes vient de s’arrêter. Et, bien entendu, un homme qu’on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur […].
Entre la peur très générale d’une guerre que tout le monde prépare et la peur toute particulière des idéologies meurtrières, il est donc bien vrai que nous vivons dans la terreur. Nous vivons dans la terreur parce que la persuasion n’est plus possible, [...] parce que nous vivons dans le monde de l’abstraction, celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuances.
Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l’amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. »
L'auteur de L’Étranger affirme refuser « un monde où le meurtre est légitimé et où la vie humaine est considérée comme futile ». Pour lui, la question centrale, préalable à toute réflexion politique, est la suivante : « Oui ou non, directement ou indirectement, voulez-vous être tué ou violenté ? Oui ou non, directement ou indirectement, voulez-vous tuer ou violenter ? ».
Car pour Camus, souscrire au programme de l'un ou l'autre des deux grands systèmes de l'après-guerre (le capitalisme américain et le communisme soviétique), ce serait, dans l'éventualité d'une guerre atomique, se faire complice des morts à venir. C'est pourquoi il va développer, dans le second article de la série, « Sauver les corps », un thème qui deviendra central dans toute sa pensée : le refus des idéologies.
« En somme, les gens comme moi voudraient un monde, non pas où l’on ne se tue plus (nous ne sommes pas si fous !), mais où le meurtre ne soit pas légitimé […]. Car nous vivons justement dans un monde où le meurtre est légitimé, et nous devons le changer si nous n’en voulons pas.
Mais il semble qu’on ne puisse le changer sans courir la chance du meurtre. Le meurtre nous renvoie donc au meurtre et nous continuerons de vivre dans la terreur, soit que nous l’acceptions avec résignation, soit que nous voulions la supprimer par des moyens qui lui substitueront une autre terreur. »
« Nous sommes décidés à supprimer la politique pour la remplacer par la morale », écrivait déjà Camus dans un de ses premiers éditos pour Combat. Renvoyant dos à dos les doctrines « marxiste et capitaliste », il explique qu'« il s’agit, en somme, de définir les conditions d'une pensée politique modeste, c’est-à-dire délivrée de tout messianisme, et débarrassée de la nostalgie du paradis terrestre».
Une critique explicite du marxisme qu'il développera dans l'article suivant, « Le socialisme mystifié »: pour lui, les socialistes doivent ainsi renoncer « au marxisme comme philosophie absolue, se bornant à en retenir l’aspect critique, souvent encore valable ».
« Il faudra choisir alors une autre utopie, plus modeste et moins ruineuse. C’est ainsi du moins que le refus de légitimer le meurtre force à poser la question. Oui, c’est la question qu’il faut poser et personne, je crois, n’osera y répondre légèrement. »
L'idée de révolution à l'échelle nationale lui apparaît d'ailleurs dépassée, à l'heure où aucun pays ne peut se targuer de vivre en autonomie par rapport à ses voisins. Il poursuit :
« Ce que ce mot [la révolution] contient aujourd’hui doit être accepté en bloc ou rejeté en bloc. S’il est accepté, on doit se reconnaître responsable conscient de la guerre à venir. S’il est rejeté, on doit, ou bien se déclarer partisan du statu quo, ce qui est l’utopie totale dans la mesure où elle suppose l’immobilisation de l’histoire, ou bien renouveler le contenu du mot révolution, ce qui présente un consentement à ce que j’appellerai l’utopie relative [...].
Il n’est pas difficile de voir que [...] cette utopie relative est la seule possible et quelle est seule inspirée de l’esprit de réalité. »
Une « utopie relative », donc, plutôt qu'une révolution qui ne saurait mener qu'à une nouvelle guerre. Camus plaide alors pour la création d'une vaste « démocratie internationale ». C'est l'objet de son cinquième article.
« Le pain de l’Europe est à Buenos-Aires, et les machines-outils de Sibérie sont fabriquées à Detroit. Aujourd’hui, la tragédie est collective. Nous savons donc tous, sans l’ombre d’un doute, que le nouvel ordre que nous cherchons ne peut être seulement national ou même continental, ni surtout occidental ou oriental. Il doit être universel [...].
Qu’est-ce que la démocratie nationale ou internationale ? C’est une forme de société où la loi est au-dessus des gouvernants, cette loi étant l’expression de la volonté de tous, représentée par un corps législatif. Est-ce là ce qu’on essaie de fonder aujourd’hui ? On nous prépare, en effet, une loi internationale. Mais cette loi est faite ou défaite par des gouvernements, c’est-à-dire par l’exécutif.
Nous sommes donc en régime de dictature internationale. La seule façon d’en sortir est de mettre la loi internationale au-dessus des gouvernements, donc de faire cette loi, donc de disposer d’un parlement, donc de constituer ce parlement au moyen d’élections mondiales auxquelles participeront tous les peuples. »
Camus fait ici référence à l'actualité immédiate : le 23 octobre 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies (créée un an plus tôt) s'était réunie à New York pour la seconde partie de sa première session, qui allait durer jusqu'au 15 décembre. L'écrivain né en Algérie pointe d'ailleurs, dans son sixième article, « Le monde va vite », le manque de représentativité des « civilisations colonisées » au sein des discussions. Et ajoute, dans la septième partie de son texte :
« Le sort des hommes de toutes les nations ne sera pas réglé avant que soit réglé le problème de la paix et de l’organisation du monde. Il n’y aura de révolution efficace nulle part au monde avant que cette révolution-là soit faite. Tout ce qu’on dit d’autre, en France, aujourd’hui, est futile ou intéressé [...].
Oui, nous devons enlever son importance à la politique intérieure. On ne guérit pas la peste avec les moyens qui s’appliquent aux rhumes de cerveau. Une crise qui déchire le monde entier doit se régler à l’échelle universelle [...]. Il faut donc que ces hommes, un à un, refassent entre eux, à l’intérieur des frontières et par-dessus elles, un nouveau contrat social qui les unisse suivant des principes plus raisonnables [...].
Un code de justice internationale dont le premier article serait l’abolition générale de la peine de mort, une mise au clair des principes nécessaires à toute civilisation du dialogue pourraient être ses premiers objectifs. »
Enfin, Camus se résume dans son dernier texte, « Vers le dialogue », dans lequel l'écrivain signe un véritable appel à la non-violence :
« Je sais bien qu’il faut aux hommes de grands mobiles pour se mettre en marche et qu’il est difficile de s’ébranler soi-même pour un combat dont les objectifs sont si limités et où l’espoir n’a qu’une part à peine raisonnable. Mais il n’est pas question d’entraîner des hommes. L’essentiel, au contraire, est qu’ils ne soient pas entraînés et qu’ils sachent bien ce qu’ils font. Sauver ce qui peut encore être sauvé, pour rendre l’avenir seulement possible, voilà le grand mobile, la passion et le sacrifice demandés [...].
On nous demande d’aimer ou de détester tel ou tel pays et tel ou tel peuple. Mais nous sommes quelques-uns à trop bien sentir nos ressemblances avec tous les hommes pour accepter ce choix […]. Ce qu’il faut combattre aujourd’hui, c’est la peur et le silence, et avec eux la séparation des esprits et des âmes qu’ils entraînent.
Ce qu’il faut défendre, c’est le dialogue et la communication universelle des hommes entre eux. La servitude, l’injustice, le mensonge sont les fléaux qui brisent cette communication et interdisent ce dialogue. C’est pourquoi nous devons les refuser. »
Avec « Ni victimes ni bourreaux », Camus pose les bases de sa rupture définitive avec l'idéologie communiste, rupture qui sera approfondie plus tard par sa dénonciation des camps soviétiques. Ce qui lui attirera les foudres des intellectuels marxistes et de Jean-Paul Sartre, en 1952, lors d'une polémique célèbre.
–
Pour en savoir plus :
Albert Camus, A Combat, éditoriaux et articles (1944-1947), Folio Essais, 2014
Olivier Todd, Albert Camus, une vie, Folio, 1999
Catherine Camus, Albert Camus, solidaire et solitaire, Michel Lafon, 2010