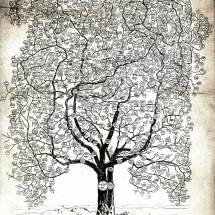XIXe siècle : débuts d’une industrie de l’alimentation en France
En moins de 200 ans, nous avons été transportés de la subsistance autonome vers l’interconnexion planétaire, le « marché mondial ». L'historien de la consommation Anthony Galluzzo nous éclaire sur ce qui a rendu possible cette révolution alimentaire.
Anthony Galluzzo est maître de conférences à l’université de Saint-Étienne. Il vient de faire paraître dans la collection Zones des éditions La Découverte La Fabrique du consommateur, un essai revenant sur les grandes étapes historiques de la progressive « conversion à la consommation » dans le monde occidental, des débuts du XIXe siècle à la société de consommation telle que nous la connaissons.
Nous publions ci-dessous un court extrait de cet ouvrage éclairant avec l’aimable autorisation des éditions La Découverte.
–
L’avènement de la mobilité marchande bouleverse le travail et accroît sa division. Les multiples communautés humaines, jusqu’alors sédentaires et insulaires, vont être mises en mouvement et en réseau. Elles vont progressivement abandonner la polyculture autarcique, l’économie de subsistance, pour adopter des productions spécialisées en direction du marché.
Le phénomène est bien illustré par l’anthropologue Laurence Wylie, dans l’histoire qu’il fait de Peyrane, un village du Vaucluse :
« En 1801, année du premier recensement officiel effectué en France, les 1 195 habitants de Peyrane vivaient presque complètement en circuit fermé. Le village formait le centre économique et culturel de la vie communautaire car les routes étaient mauvaises et les communications avec l’extérieur extrêmement réduites. On pratiquait un peu l’élevage des vers à soie dont on envoyait les cocons à Avignon, mais l’essentiel de l’activité économique tendait à satisfaire les besoins de chaque famille et de la communauté dans son ensemble. On y cultivait les produits traditionnels de la région méditerranéenne : le blé, les légumes secs, les olives, la vigne, le miel, les figues et les amandes. Moutons et chèvres fournissaient le lait, la laine, un peu de viande et – détail important – les matières nécessaires à fertiliser les sols. [...]
Le rendement était faible, les récoltes étaient maigres. [...] Le niveau de vie des habitants était bas. […]
Le Peyrane de 1851 était très différent. Du fait du développement des moyens de transport, l’autarcie avait en partie perdu sa raison d’être. Sans abandonner leurs cultures traditionnelles, les habitants pouvaient désormais faire venir de l’extérieur les produits qui leur manquaient. Ces achats devenaient possibles grâce aux modifications apportées à l’économie locale. On cessa de donner la priorité aux denrées destinées à la consommation familiale pour se consacrer aux produits vendables hors de la commune. Une nouvelle culture – la garance – contribua à augmenter les revenus de la région.
Au cours de la première moitié du XIXe siècle, l’élevage du ver à soie connut un grand développement. »
« Économie rurale », critique de l’ouvrage Traités sur l’éducation des vers à soie, La Gazette de France, juin 1809
La spécialisation fonctionnelle s’observe partout ailleurs à la même période : le Languedoc intensifie sa production de vin ; des villes balnéaires et thermales éclosent, alimentées en touristes par le train... Dans l’économie nouvelle, la production n’a plus pour fin la consommation directe, domestique et communautaire, mais la vente. Les produits nécessaires à la subsistance sont achetés, ils viennent de l’extérieur, du marché. On ne produit plus pour soi, mais pour le monde. Le renversement est qualitatif ; la nature même de la production s’en trouve changée.
L’objet n’existe plus simplement à travers sa valeur d’usage, il devient une marchandise, un produit transmis par la voie de l’échange, « de la valeur d’usage pour d’autres, de la valeur d’usage sociale ». Dans une économie de subsistance traditionnelle, l’homme a fabriqué ou a vu fabriquer – par les artisans de son village – la plupart des objets qu’il manipule. Dans l’économie de marché, les objets sont conçus au loin, par des inconnus, et selon des procédés de plus en plus sophistiqués et inaccessibles. C’est le processus de fétichisation : l’objet, qui était autrefois le produit direct du travail communautaire, est devenu, avec la marchandisation, un phénomène étrange et étranger, détaché du contexte et du processus concrets de production.
Ce rapport fétiche à la marchandise nous permet de comprendre la nature de l’objet de consommation. Dans une économie de marché, l’homme posant son regard sur une marchandise n’est plus à même de la saisir en tant que produit. Il n’est plus capable de voir en elle du temps de travail accumulé. […]
Publicités en faveur de revues et de cours spécialisés se proposant d’enseigner « l’économie rurale », La France, novembre 1842
Illustrons ce phénomène à travers le cas de l’alimentation. Jusqu’à l’avènement du marché, la plupart des hommes – des paysans, comme on l’a vu – cultivent eux-mêmes leur nourriture. Ils plantent les graines, battent les blés, ramassent les châtaignes et tuent le cochon. Ces gestes ancestraux reculent à partir de la fin du XIXe siècle à la faveur de nouveaux : il s’agit désormais d’aller « faire les courses », de prélever, sur les rayonnages, bocaux de légumes, bouteilles de lait, paquets de biscuits et autres boîtes de conserve, pour les ranger ensuite, chez soi, dans des placards. Le foyer, centre de la production domestique, devient dès lors un lieu d’entreposage et de consommation des marchandises. La production alimentaire s’échappe du carcan communautaire, elle est absorbée par de grandes entreprises pratiquant une culture, un conditionnement et une distribution de masse. Par cette coupure, par cette distanciation, les aliments eux-mêmes changent de nature : ils entament une existence distincte.
Prenons, pour être plus explicite encore, le cas du cochon. Chez le villageois français de 1800, le cochon est l’animal domestique, qui souvent se promène librement dans la cour et dans la maison. Engraissé pendant un an, le cochon est abattu, généralement à la Toussaint, par un tueur de goret, maître local de l’art de la saignée. Ce tueur arrive équipé de tous ses outils, et les hommes de la famille l’aident dans son office : le cochon est pendu ou allongé, piqué à la carotide et saigné.
Une fois mort, il est flambé, arrosé, raclé, puis suspendu, ouvert, éviscéré et dépecé. L’animal est ensuite entièrement transformé : pendant quelques jours, toute la famille, mais aussi souvent les voisins, participe au rituel, qui se clôt par un grand repas où les morceaux sont partagés. La tuerie du cochon est une fête qui marque le début de l’hiver et pendant laquelle un savoir et des gestes ancestraux sont transmis, par la répétition, des parents aux enfants. L’élevage, la tuerie, la transformation et la consommation : toutes ces étapes de production et de consommation sont mêlées, liées dans un continuum, selon une unité de temps, de lieu et d’acteurs.
Paroles de la chanson populaire « La Foire aux jambons », Paris, avril 1890
Il en va tout autrement dans la modernité marchande. Le consommateur français d’aujourd’hui se saisit de ses saucisses de porc, emballées dans des barquettes en polystyrène et sous film PVC, et entreposées dans les vitrines réfrigérées de son super-marché. Elles y ont été livrées par camion frigorifique, certainement depuis la Bretagne, qui concentre l’essentiel des infrastructures d’élevage hors-sol et d’abattage. Pour saisir le moment où le cochon est devenu produit, il faut remonter de nombreuses médiations marchandes : du supermarché à sa centrale d’achats, de celle-ci aux grossistes, aux courtiers, à l’abattoir et finalement à l’éleveur.
Tantôt virtuellement, tantôt physiquement, la viande est passée de main en main, dans un circuit qui reste, dans notre exemple, relativement court, puisque les abattoirs bretons envoient leur viande congelée jusqu’en Chine. Les gestes de la tuerie, aussi, se sont dilatés : la saignée, l’échaudage, l’épilage, le grattage, l’éviscération et le dépeçage ne sont plus des actions qui se succèdent chez un même homme, mais les étapes d’une vaste chaîne industrielle où se relaient des centaines d’ouvriers monotâches. […]
Ce bouleversement de l’ordre productif a des conséquences très concrètes dans l’imaginaire du consommateur. Lorsque le paysan d’hier cuisinait une saucisse, il percevait de la chair de cochon, broyée au hachoir et mélangée à du gras, puis enfilée dans des boyaux, des viscères préalablement vidés et lavés. Il percevait à travers le produit, pour les avoir accomplis, un ensemble de gestes, mais également le porc lui-même : il avait plongé ses mains dans les entrailles encore fumantes de l’animal pour en extraire les pièces de viande. Le filet, l’entrecôte, le jarret étaient pour lui des repères anatomiques, alors qu’ils sont pour le consommateur contemporain de simples catégories de produit.
Extrait d’une audience au tribunal de Paris mettant en scène un consommateur insatisfait de la marchandisation de l’alimentation, La Quotidienne, mai 1837
La pièce de viande empaquetée dans une barquette de polystyrène, c’est la chair devenue abstraction, c’est l’animal fétichisé.
Par la dislocation et l’éparpillement toujours plus vaste des tâches d’élevage, d’abattage, de transformation et de consommation, la viande est devenue chose en soi ; un objet autonome dont on ignore les constituants exacts et à propos desquels, d’ailleurs, on ne s’interroge pas.
–
La Fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande d’Anthony Galluzzo est paru en juin dans la collection Zones des éditions La Découverte.