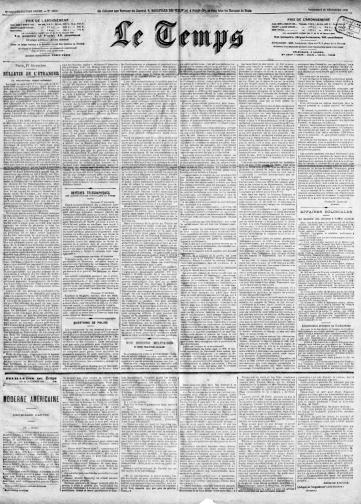Extrait du journal
Il s’est produit hier l’un des événements finan ciers les plus curieux qui se puissent imaginer. La Banque de France s’est vue obligée de sus pendre... — Ses payements ? — Oh ! non ; c’est même presque tout le contraire. Bien loin d’avoir trop de billets et d’être ainsi dans l’im puissance de les rembourser à vue, notre pre mier établissement de crédit a dû renoncer à faire face aux demandes de billets de banque et il a contraint le public à accepter de la monnaie métallique. Voiîà, on l’avouera, un singulier cours forcé ! — Quel paradoxe nous faites-vous? sera-t-on tenté de dire. Pourquoi la Banque irait-elle refuser des billets à ceux qui lui en réclament? Si on lui apporte de l’or en échange de son pa pier, pourquoi refuserait-elle d’enrichir son en caisse?— La raison en est fort simple : l’Etat lui interdit cet échange. — Est-ce possible? — On croit rêver, et, pourtant, c’est ainsi. L’Etat a défendu à la Banque de porter la circu lation fiduciaire au-dessus de 3 milliards et demi. Ce niveau a été atteint hier. La faculté démission a été, du coup, supprimée. La France possède toujours une Banque d’émission, et même une Banque privilégiée, co qui donne lieu aux discussions que l’on^ait; seulement ce beau privilège consiste, pour l’instant, à ne pas pouvoir légalement créer unbilletdevingt francs. Nous avons, à maintes reprises, appelé l’at tention du gouvernement et des Chambres sur les inconvénients, sur les dangers même, d’un maximum imposé arbitrairement à la circula tion fiduciaire. Qu’en temps de crise exception nelle, pendant une révolution ou pendant une guerre, l’Etat fixe une limite à l’émission, afin de rassurer l’opinion contre tout retour au pa pier-monnaie, on peut, certes, l’admettre. Ce peut être, alors, une précaution excellente de l’Etat contre ses propres entraînements. En 1848, en 1870, cette garantie a été donnée au pays ; bien que le gouvernement soit tenté, dans ce cas, de reculer peu à peu la barrière qu’il a eu la prudence d’élever, on estime qu’elle ne sera pas toujours inutile. Mais, en pleine paix, alors que la situation est normale, quand la sortie des billets a pour causo exclusive le mouvement régulier des affaires, quels motifs peut-on invoquer en faveur d’u.ne interdiction d’émission? Qu’on so montre sévère dans le choix des opérations d’où naîtront les billets de banque, rien de plus na turel ; mais ces opérations une fois déterminées et reconnues saines, légitimes, comment peuton venir, par un maximum d’émission, en em pêcher la réalisation? Ce qui met le comble à la bizarrerie de la si tuation actuelle, c’est que la Banque de France, en dépit du chiffre en apparence si gros de sa circulation, n’a qu’une émission fiduciaire en réalité très modique. Le public a pris l’habitude ' de recourir, pour nombre de ses payements, au billet de banque, plus portatif, d’un maniement plus commode que l’or ou l’argent. Les espèces métalliques affluent, en conséquence, à la Banque. Au 12 janvier, elle avait dans ses caves près de 3 milliards de métaux précieux, soit, exactement, une somme de 2 milliards 959 mil lions, Ainsi, une circulation de 3 milliards 500 millions en billets représentait, en tout et pour tout, 541 millions de monnaie fiduciaire non adossée à une encaisse effective. En d’au tres termes, l’émission qui correspond à des opérations financières ou commerciales réelles, abstraction faite de l’échange pur et simple de billets contre des espèces, dépasse à peine un demi-milliard. Et c’est dans cette situation que les services de la Banque risquent d’être arrêtés! La plaisanterie est forte, il en faut convenir. La Banque a, il est vrai, le droit de puiser, maintenant, à son encaisse pour continuer ses opérations. Mais, puisque le public préfère des billets à des espèces, pourquoi le priver de la monnaie qu’il désire? Pourquoi arrêter le dé veloppement si intéressant des réserves d’or de notre grand établissement financier? La cir culation intérieure s’enrichira, nous voulons l’admettre; mais, tant que les changes nous sont favorables et tant que l’or ne fait chez nous aucune prime, elle peut être tenue pour normale ; dans ces conditions, il n’y a au cune raison de refouler hors de la Banque les métaux précieux qui démandent à s’y accumuler. Notre première institution de crédit peut se voir, d’ailleurs, dans l’impossibi lité de subvenir, avec des espèces, à tous les besoins, non pas que l’encaisse ne soit suffi sante, mais parce que les payements en billets sont beaucoup plus rapides. Que les sociétés de dépôts aient de larges réescomptes à effectuer, qu’une soudaine affluence de demandes se pro duise, une crise peut se déclarer, crise absurde, sans l’qmbré d’un prétexte, et qui n’en cause- ' rait pas moins de vives souffrances. Le devoir du gouvernement est, dès lors, tout tracé. Le maximum fixé à l’émission fait tout le mal : que ce maximum disparaisse. Une loi l’a éta bli. En quarante-huit heures, une autre loi peut l’abolir. Le gouvernement serait, ce nous semble, d’autant moins fondé à hésiter qu’il a, sans y prendre garde, contribué au présent état de choses. Voyant que la limite fixée à l’émission n’était plus loin d’être atteinte, il avait une con duite .toute simple- à1 tenir, dans l’hypothèse, où il n’eût pas été disposé à faire supprimer le maximum : il devait éviter de; réduire son compte-courant créditeur. Or, en quinze jours, du 29 décembre 1892 au 12 janvier 1893, le Tré sor a retiré 140 millions à la Banque. Mais peu importe cette erreur, si elle est réparée à bref délai. Que le maximum, imposé à l’émission des billets vienne à tomber : toutes les difficultés s’évanouiront. ' . — AFFAIRES COLONIALES....
À propos
Le Temps, nommé en référence au célèbre Times anglais, fut fondé en 1861 par le journaliste Auguste Neffzer ; il en fit le grand organe libéral français. Il se distingue des autres publications par son grand format et son prix, trois fois plus élevé que les autres quotidiens populaires. Son tirage est bien inférieur à son audience, considérable, en particulier auprès des élites politiques et financières.
Données de classification - ribot
- massie
- de caprivi
- caprivi
- brazza
- hubbard
- crespel
- casimir-perier
- maes
- tourane
- france
- congo
- stanley
- allemagne
- tonkin
- russie
- bruxelles
- le congo
- zanzibar
- paris
- la république
- parlement
- association internationale africaine
- journal officiel
- union postale
- banque de france
- comité d'études ot
- banque nationale
- comités d'action
- parlement français