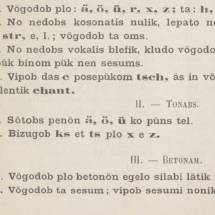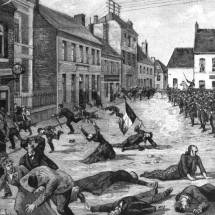Il semble ignorer autre chose : peu de temps auparavant, le mot « Valentin » avait fait son entrée dans le dictionnaire de Furetière, par l’intermédiaire de Duchat, éditeur de Rabelais au début du XVIIIe siècle – et par là particulièrement au fait des rites carnavalesques. Duchat, en 1711, avait effectivement mentionné en note de Pantagruel, lorsque le mot « Valentin » apparaît dans le texte de Rabelais (cf. gallica, édition de 1741) :
« C'est la coûtume en plusieurs Villes de France, que le soir du premier Dimanche du Carême, les petites gens de la ruë assignent à haute voix aux jeunes garçons et aux filles du Quartier des Valentins et des Valentines, c'est-à-dire des galans et des maîtresses. »
Cette occurrence, qui à ma connaissance est restée inaperçue des études sur la Saint-Valentin, offre deux conséquences importantes. La première, c’est qu’elle confirme la prudence nécessaire à toute affirmation sur les origines des rites valentins. Le 14 février disparaît ici au profit d’une date mobile du cycle carnaval-carême, et Duchat prend la peine d’indiquer qu’il parle des « petites gens ». Il ne s’agit pas d’une preuve décisive, mais pour le moins d’un sérieux rappel de notre ignorance. Ramener l’observation de Duchat à une conséquence directe d’une invention de poésie de cour me semble extrêmement hasardeux. Pour les rites non liturgiques auxquels nous prenons part, il faut admettre que nous sommes tributaires d’une histoire dont nous ignorons sans doute l’essentiel.
La seconde conclusion est moins déprimante. Si votre moitié est attachée à la célébration de la Saint-Valentin, et que vous avez oublié la date, vous avez désormais une excuse historiquement documentée : la « coutûme » française, attestée au début du XVIIIe siècle par l’érudit Duchat, pose la célébration amoureuse au premier dimanche du Carême, la Quadragésime, c’est-à-dire, cette année, le 21 février. Vous avez donc sept jours pour vous rattraper.
–
Pour en savoir plus :
P. Saintyves, « Valentines et Valentins : les rondes d'amour et Cendrillon », Revue de l'histoire des religions, vol. 81 (1920), pp. 158-182
A. Van Gennep, « La Chandeleur et la Saint-Valentin en Savoie », in: Revue d'ethnographie et des traditions populaires, t. V, 1924, pp. 225-245
J. B. Oruch, « St. Valentine, Chaucer, and Spring in February », Speculum, vol. 56 (3), 1981, pp. 532-565
–
Anton Serdeczny est historien, docteur en histoire de l’EPHE. Il est l’auteur de Du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation, paru aux éditions du Champ Vallon en 2018.